2 Donnotravos : le Tarvos Trigaranos, Taureau primordial + Étude sur le taureau et le pilier des Nautes

Esus, l'arbre monde et le Tarvos Trigaranos (tarvos = taureau et garan = grue) Le taureau sacré surmonté de 3 grues ou hérons (La grue ou héron est un animal sacré psychopompe symbole de la puissance créatrice qui est aussi souvent assimilé au cygne, forme que prennent les divinités dans le monde humain)
LES 3 GRUES
les trois grues (garanus) étant selon cet érudit un rébus pour trois cornes (trikeras), et probablement même pour trois têtes (trikarenos).
Cette équivalence montre en tout cas que les trois cornes symbolisent plus que la suprématie d’un « roi des taureaux ».
En tant que talisman dans la période gallo-romaine, il symbolisera encore la fécondité, la force vivifiante et donc protectrice.
*les 3 cornes du Taureau représentent les 3 phases de la lune
*Les 3 grues représentent les 3 cornes du Taureau et sont des Vénus de l'eau
*Les 3 phases de la lune représentent la naissance, la vie et la mort
*Les Vénus de l'eau représentent Le passé (glacé) le présent (liquide) le futur(gazeux)
Les grues sont trois, ce qui correspond à leur formation de vol minimale derrière un conducteur ;
Suivant les anciennes croyances, le grues disparaissaient dans le enfers en automne pour réapparaître au printemps ( en fait elles migraient )
Les grues font d’une certaine manière partie du taureau mythique qu’elles soient campées sur son dos à Paris ou « cachées » dans l’arbre avec lui à Trèves.
Celà rappelle étonnamment les aigrettes sur dos des taureaux qui le débarrassent de la vermine. On trouve d'ailleurs les aigrettes dans les marais et au bord des eaux là où poussent, les saules.
Troublante équations ecologico-religieuse regroupant les éléments de la représentation Taureau/grue/arbre monde
Le sacrifice du taureau permettait à la grande Rigani de se retransformer en Déesse après avoir eu le triple aspect d’une grue, triple aspect qui la relie au principe de vie-mort-renaissance.
Ce mythe nous plonge évidemment dans le monde magique de la revitalisation cyclique des forces de la nature.
Les grues sont liées aux Mères associées elles-mêmes aux phases de la lune et au chant magique de la destinée qui naissent, en même temps que l’abondance, de la tête du taureau, et que son immolation fait naître la vie et déclenche en quelque sorte le cours du temps. Dans leur migration, les grues conduisent la venue et le départ des âmes avec les grandes saisons…
On aurait donc affaire à un mythe des origines, susceptible d’être évoqué et reproduit symboliquement lors de tout événement fondateur.
Ann Ross a justement consacré une étude aux oiseaux d’Esus à laquelle nous nous référons plusieurs fois. Selon elle, ces oiseaux correspondent à de petites aigrettes et non à des grues.
Elle indique toutefois, qu’au niveau mythologique, cette différence n’a pas grande importance puisque la taxinomie des Celtes était fonction des catégories d’oiseaux ; ainsi, la plupart des oiseaux des marais à longues pattes devaient appartenir à un type identique.
La langue irlandaise témoigne de cette façon de procéder : corr désigne à la fois le « héron », la« grue » et parfois la « cigogne ».
Cependant, cette distinction a de l’importance sur le plan de l’histoire naturelle. La petite aigrette vit dans les marécages des bas-fonds ou dans les pâturages proches des rivières ; de plus, elle a tendance à se percher sur le dos du bétail et à le débarrasser de la vermine. Cela pourrait alors expliquer que sur les monuments gaulois, ce type d’oiseaux soit représenté sur le dos du taureau.
Un autre élément vient compléter cet ensemble écologique. Selon Ann Ross, l’arbre d’Esus est un saule, une espèce qui pousse elle aussi dans les marais et sur les bords des rivières. Les monuments de Paris et Trèves seraient donc la représentation d’une association écologique.
Dans l’iconographie celtique, les grues sont fréquemment représentées.
À la période de Hallstatt, les oiseaux aquatiques – comme les grues – avaient des rapports étroits avec les divinités solaires et les chevaux ; ils pouvaient également tirer des chariots miniatures dans lesquels était placée l’image de la divinité.
Les grues sont donc associées au soleil et aux chevaux, deux thèmes qui caractérisent Lugus.
À l’époque gallo-romaine, la grue et l’aigrette sont souvent représentées en compagnie de Mercure.
La présence de ces oiseaux atteste du caractère indigène de ce dieu puisqu’ils ne sont pas des attributs du Mercure classique.
Plusieurs pièces archéologiques peuvent confirmer la relation entre cet oiseau et le dieu gallo-romain. Nous avons tout d’abord la dalle de Beaumont (Puy-de-Dôme), en provenance d’un temple de Mercure, qui représente deux grues avec chacune un serpent dans le bec.
Mentionnons également deux pièces qui témoignent de l’association entre la grue et la guerre :
cet oiseau figure sur les couvre-joue d’un casque gaulois de Carniole (Slovénie) et sur les boucliers gaulois de l’arc d’Orange.
Nous avons là un nouveau point commun entre la grue et Lugus, étant donné que ce dieu dispose de caractères guerriers reconnus. Plusieurs monnaies montrent un taureau sur le dos duquel est posé un oiseau identifiable à une grue ; cette scène rappelle bien entendu les monuments de Paris et Trèves.
LE TARVOS TRIGARANOS
Le taureau représente la force et la puissance sexuelle et guerrière.
Le taureau était considéré comme l'agent visible de la force invisible qui meut et féconde la nature.
Le sacrifice du taureau par Mithra paraît avoir évoqué aux yeux des Gallo-romains le sacrifice annuel des taureaux en l’honneur de la déesse-mère : sur des bas-reliefs, la représentation du sacrifice de Mithra est associée à la déesse-mère. Souvent représentée en triade et appelées après la conquête romaine Matrae.
.Tarvos est il la forme animale de Taranis?
Se cache t'il sous cette forme d'un Esus que Rigani a quitté et qui c'est elle même transformée en grues?
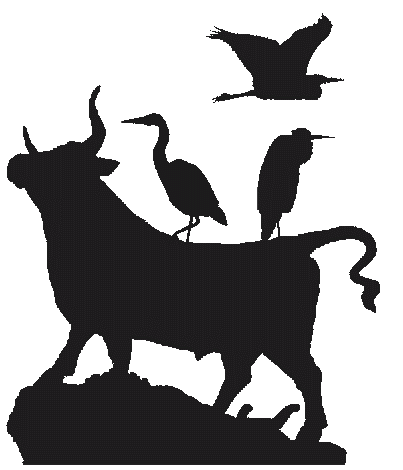
Étude sur le taureau et le pilier des Nautes
Dans un texte d’Ovide, Érysichton abat délibérément le chêne sacré de Déméter : « Que ce chêne soit non pas seulement l’arbre favori de la déesse mais la déesse elle-même, peu importe ! » Or, voilà que « par l’écorce fendue jaillit un jet de sang, tout de même que, lorsque devant les autels s’abat la victime, en énorme taureau, du cou ouvert on voit le sang couler, à flots ».
L’image produite par Ovide tend manifestement à assimiler l’arbre au taureau ( blesser l’arbre équivaut à égorger un taureau). Or, il existe au moins une autre histoire pour étayer cette assimilation : la légende d’Ariane.
Ariane, fille de Minos et de Pasiphaé passe pour une figure de la végétation : elle était souvent représentée sur les figurines pendues aux branches des arbres.
Elle est intégrée, comme on le sait, à l’histoire du Minotaure, son demi-frère caché dans le labyrinthe crétois.
Ce monstre à corps d’homme surmonté d’une tête/protomé de taureau était le fruit des amours de Pasiphaé avec le taureau de Minos : pour séduire la bête dont elle était amoureuse, et s’unir à elle, Pasiphaé se serait cachée à l’intérieur d’une vache en bois, œuvre de Dédale .
On n’a pas assez souligné l’étrangeté du matériau choisi par Dédale :
pourquoi en bois, pour un taureau ? On voit ainsi, dans ce groupe légendaire, Pasiphaé qui se présente comme une sorte d’« arbre /vache en bois » dans laquelle vient se loger mystérieusement un taureau, avec une fille (Ariane), possible déesse de la végétation .
L’histoire se poursuit avec la mention de grues :
au sortir du labyrinthe , Thésée vainqueur exécute en effet une « danse de la grue » (ou γέρανος ) , danse mêlant les jeunes gens des deux sexes selon un parcours complexe (qui passait pour reproduire les méandres du labyrinthe 142).
Plutarque (Thésée, 21) situe cette danse « autour du Kératôn » (περι τὸν Κερατῶν), l’autel composé uniquement de cornes de chèvres bâti par Apollon (Callimaque, Hymne à Apollon, 55-64), autel qui est vraisemblablement l’« autel délien », ou « autel de Délos », c’est-à-dire l’autel d’Apollon .
Sans vouloir ajouter du mystère supplémentaire à l’énigme du labyrinthe, il semble qu’on puisse rapprocher de cet intrigant triptyque crétois «arbre/taureau/grues », une célèbre figure mythologique, attestée à Paris sur le « Pilier des Nautes » ( pilier doublement dédicacé à Tibère -14-37 apr. J.-C. – et à Jupiter par la corporation des bateliers du territoire des Parisii ) sous le nom de « Tarvos Trigaranus» peut être approché de cet intrigant triptyque crétois
« arbre/taureau/grues ».
Ce pilier présente en effet les trois mêmes éléments qu’on trouve associés en Crète :
un magnifique taureau, représenté devant un arbre, avec trois grues perchées sur son dos et sa tête (on retrouve la même image qu’à Paris dans un autre relief trouvé à Trèves [ Esp. 4929 – C.I.L., XIII, 3656], où un arbre, dans les branches duquel sont des grues et une tête / protomé de taureau, est abattu par un bûcheron ).
On pourrait croire que ce Tarvos Trigaranus, venant d’un contexte culturel totalement différent, est complètement étranger à la Grèce. Non : quelques vers d’une comédie perdue de Philémon ( IV e - IIIe siècles av. J.-C., nitiateur avec Ménandre de la Comédie nouvelle) conservés par Athénée , mentionnent un θηρίον τρυγέραυον , qui paraît être un décalque grec du Tarvos Trigaranus .
Des monnaies de Gortyne montrent pareillement un arbre auquel une tête de taureau est suspendue.
Que représente ce taureau (entier ou en protomé), associé aux grues et à l’arbre ? Il est bien sûr difficile de le dire. Peut-être, si nos analyses sont bonnes, peut-on trouver une clé du côté des Pléiades, ce groupe de sœurs auquel Maïa appartient, et que les Grecs rangeaient parmi les constellations célestes :
les Pléiades figurent dans le Taureau, groupe d’étoiles symbole du printemps mais au sexe ambigu.
En astronomie, le Taureau était le « domicile » de Vénus, et la Lune s’y trouvait en « exaltation » : double orientation féminine.
Nous ferons donc l’hypothèse suivante :
dans toutes ces histoires (Pasiphaé possédée par un taureau alors qu’elle est revêtue de bois ; l’arbre qui saigne comme un taureau qu’on égorge ; l’arbre au taureau des reliefs gallo-romains, etc.).
le végétal symboliserait la réunion complexe (car antagoniste) d’une déesse (de la Terre Mère, gardienne des richesses ?) et d’un dieu (du feu, ou souffle vital ?) dans une sorte de composé androgyne .
On comprendrait la difficulté pour les sculpteurs de représenter concrètement un composé si abstrait (mais imposé par les conventions religieuses) :
ils n’auraient – assez maladroitement – résolu la difficulté qu’en juxtaposant des signes contradictoires dans un ensemble protéiforme et foisonnant (un arbre avec un taureau ou une tête de taureau, des grues).
Il faut noter que sur les trois autres côtés du troisième dé du pilier sont figurés, à côté du Tarvos Trigaranus :
Jupiter ; un nommé Ésus en tenue de travailleur, abattant un arbre à la hache ;
Volcanus/Vulcain.
On pourrait faire l’hypothèse que ce troisième dé donne quatre figurations symboliques d’un même couple divin :
1. Sous la forme du taureau à l’arbre (Tarvos Trigaranus), qui désigne une grande déesse avec son parèdre masculin destructeur/ constructeur, qu’elle porte au sein du bois ;
2. Du bûcheron, qui élague l’arbre (ce même parèdre masculin : Ésus) ;
3. Du dieu du feu/Volcanus (qui brûle le bois, ou le transforme) ;
4. Du dieu suprême à la romaine, qui englobe tous les aspects précédents du parèdre masculin: Jupiter.
sur le pilier de Paris, le Tarvos Trigaranus apparaît comme un « taureau devant un arbre et sur qui sont perchés trois échassiers :
les grues (gallois garan « grue »), ainsi que sur une face latérale d’une stèle votive de Trèves (dédiée à Mercure), sous la forme d’une tête de taureau apparaissant avec trois oiseaux à travers le feuillage d’un arbre.
Sur le pilier de Paris, le panneau voisin montre le dieu avec son nom gaulois Ésus ébranchant un arbre à coups de serpe.
La jonction des deux scènes en un seul mythe est attestée par le fait qu’à Trèves, c’est l’arbre même où perchent les oiseaux qu’un homme, court vêtu comme l’Ésus de Paris, est en train d’attaquer le tronc avec une cognée ».
Ésus (voir Duval, 1954, 6-17) apparaît peut-être sur une inscription lacunaire au dos d’une statue de Mercure à Lezoux : Apronios ieuru sosi…esu(m ?)…
Selon Lucain (Pharsale, I, 444445), il était un des grands dieux de la Gaule (avec Taranis et Teutates) apaisé par des sacrifices sauvages.
les scholies de Lucain existantes (Manuscrit de Berne, éd. Usener 1869, texte reproduit par Deyts, 1992, 137) assimilent Ésus soit à Mars, soit à Mercure : « Ésus Mars est apaisé de cette façon :
un homme est suspendu à un arbre jusqu’à ce que, par l’écoulement de son sang, il ait laissé aller ses membres».
Comme le souligne Duval « il reste curieux […] que les seuls renseignements précis que nous ayons sur Ésus, deux bas-reliefs et une scholie, nous le montrent en rapport avec les arbres » (1989, 233).
Quant à l’hésitation des scholies de Lucain entre Mercure et Mars, elles doivent nous faire nous souvenir qu’en Grèce, Hermès n’est pas sans proximité avec Ares.
Hermès et Arès, ou Mercure et Mars (qui agissent parfois de concert, voir par exemple Antoninus Liberalis, XX, pour le châtiment de Polyphonté) pourraient-ils être les deux faces d’une même personnalité divine, l’une pacifique et qui agrège (Mercure), l’autre violente et qui désagrège (Mars)?
On pourrait peut-être expliquer ainsi le décor du quatrième dé du pilier des Nautes parisien (la partie supérieure seule est conservée), où, à coté du dieu cornu (Cernunnos), qui semble en parallèle avec le taureau cornu du dé inférieur, et d’une figure au nom gaulois de Smertrios sont représentés les Dioscures, Castor et Pollux : ceux-ci représenteraient Mercure-Ésus et Mars-Ésus/
